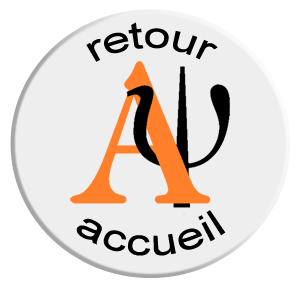La thérapie phénosociale : prendre soin de la personne comme situation psychosociale
Que faire ?
À une personne en difficulté ou en souffrance et demandant de l’aide, le thérapeute phénosocial propose un accompagnement visant à la considérer comme situation psychosociale, non comme un individu –indépendant, autonome, responsable–, en s’engageant :
- à accueillir et à écouter sa souffrance, son urgence, son désir de changement, ce qu’elle dit de ce qu’elle vit,
- à travailler activement avec elle à une transformation de l’ensemble de sa situation, dans sa globalité, tenant compte des personnes avec lesquelles elle est en relation et des environnements sociaux auxquels elle est affiliée,
- à considérer qu’elle n’est pas seule responsable, par son histoire et sa personnalité, de ses difficultés et de ses souffrances, ni que « quand on veut, on ne peut pour autant pas forcément », ou encore que « la réalisation de nos rêves ne dépend pas que de nos ressources ».
Nous ne sommes pas, et de loin, tout puissants dans nos vies, nous sommes contraints et agis par des phénomènes qui relèvent de notre propre façon d’exister et d’être au monde et par d’autres qui ne dépendent pas que de nous, qui nous traversent et nous dépassent.
Pour autant, nous pouvons nous-mêmes évoluer, en partie ; de même, les personnes auxquelles nous sommes liés et les liens que nous entretenons avec elles peuvent changer, en partie ; tout autant que les contextes sociaux auxquels nous sommes affiliés et ces liens d’affiliation qui peuvent eux aussi se transformer, en partie.
Tenir compte de l’épaisseur, de la complexité, de l’évolutivité et de l’imprévisibilité des trois dimensions –individuelle, relationnelle et sociale–, conduit le thérapeute phénosocial à reconnaître, avec lucidité, honnêteté et humilité :
- l’impossibilité de prévoir la configuration de l’ensemble qui conduira la personne à s’estimer sortie d’affaire,
- ni, a fortiori, le déroulé et la durée du cheminement qui y mène,
- la nécessité de rester ouvert aux évolutions inattendues de sa situation globale dans un ajustement continu.
Paradoxalement, prendre soin de la personne selon cette conception de l’être humain, c’est cheminer avec prudence et précaution, afin de permettre à la situation d’évoluer graduellement dans sa globalité, et accepter de na pas avoir d’itinéraire prévisible.
En cheminant séance après séance, la personne et tout son univers vont petit à petit se révéler et se transformer : le chemin se découvre et s’invente en marchant et son issue reste inconnue jusqu’à son terme.
Comment le faire ?
Être accueilli et écouté est soulageant, momentanément, mais insuffisant pour que la situation de la personne, individuelle, relationnelle et sociale, se transforme et entraîne une évolution durable de ses difficultés ou de ses souffrances. Pour contribuer activement le thérapeute phénosocial mobilise des compétences humaines-professionnelles qui constituent autant directions de travail possibles pendant la séance.
Axes de travail
Les différents axes de travail mobilisables pendant la séance par le thérapeute phénosocial déterminent ses compétences humaines-professionnelles :
- Écouter, au-delà de ses mots, accueillir la personne toute, dans sa globalité, « être-avec» elle, sur son chemin et dans ses épreuves, lui permettre de se déposer et de trouver un appui, de se sentir entendue.
- Travailler les situations difficiles ou souffrantes de sa vie, mettre au jour les implicites, identifier les évidences, saisir les dynamiques systémiques en jeu, contextualiser et complexifier plutôt que simplifier et réduire, distinguer ce qui relève de la personne de ce qui la dépasse et relève de ses contextes, envisager des éventualités, des possibles, imaginer des actions relationnelles, des engagements collectifs et militants contribue à l’évolution des relations interpersonnelles et des affiliations sociales.
- Aider la personne à devenir plus consciente des phénomènes non conscients à l’œuvre dans son vécu, lui permet de repérer en direct les façons d’être au monde dans lesquelles elle se piège et d’inventer d’autres chemins.
- S’engager de façon authentique, mais attentive, dans l’interaction avec la personne lui offre l’occasion d’une rencontre marquante et constructive, bien différente des rapports humains indifférents ou policés, durs ou brutaux.
- Créer et proposer des expérimentations permet d’explorer les situations de la personne « par l’expérience vécue », corporellement, émotionnellement, intellectuellement, activement, non seulement par ses récits, afin de les travailler « en direct » et en sécurité.
- Mobiliser un cadre professionnel explicite, à la fois contenant, soutenant et possiblement confrontant, utilisé comme outil de travail et de cheminement, plutôt que comme une réglementation policière.
Ces compétences mobilisent trois directions : phénoménologique, relationnelle et sociale.
Valeurs éthiques
Ces directions d’action se concrétisent par la mobilisation de compétences professionnelles orientée par des valeurs éthiques :
- le doute, l’humilité, le renoncement à prétendre savoir pour l’autre, à savoir à la place de la personne,
- le renoncement à prendre position au sujet de la personne sur sa vie et son avenir,
- le respect des décisions de la personne sur son existence et son devenir (de sa souveraineté sur sa vie),
- la considération pour la vulnérabilité, comme une condition même d’être un humain, non comme une tare,
- et, en écho, la considération pour la solidarité, comme indispensable à l’existence humaine.
Construction des compétences de thérapeute phénosocial
La pratique de thérapeute phénosocial évoquée ici ne relève pas d’une simple écoute, même approfondie et active, ni d’interprétations, de diagnostics, d’orientations, de conseils, d’encouragements ou d’injonctions.
Cette pratique nécessite un engagement incarné, émotionnel, cognitif, relationnel dans la rencontre avec la personne ainsi que la réalisation de gestes langagiers, attentionnels, cognitifs, interactionnels spécifiques mobilisant de nombreux savoir-faire et des qualités d’être particulières conférant au thérapeute phénosocial des compétences à la fois humaines et professionnelles.
La construction de ces compétences nécessite un apprentissage long et progressif, mettant l’apprenti au travail corporellement, émotionnellement, intellectuellement, relationnellement, dans et par l’expérience du métier et de ses différentes facettes, au fil de dispositifs pédagogiques pratiques et expérientiels, d’abord protégés puis au contact de l’activité réelle.
Ce contact avec l’activité réelle tout au long de la formation est le cas, ou devrait l’être, de toute formation de haut niveau à une pratique professionnelle, en particulier lorsque le professionnel doit agir dans l’urgence et décider dans l’incertitude : on ne peut pas apprendre un tel métier dans les livres ni sur les bancs de l’école en mémorisant des théories.
Ces compétences à la fois humaine et professionnelle ne sont donc pas innées, elles ne relèvent pas d’une vocation, et une formation théorique et académique, même complétée d’expériences pratiques ponctuelles, ne peut pas prétendre les construire.
De surcroît, la formation à cette pratique requiert, en préalable et en parallèle, un travail sur soi approfondi, afin d’avoir suffisamment « fait le ménage chez soi », de connaître ses limites et de pouvoir repérer l’influence de sa propre personnalité, de son histoire, de sa socialisation, de sa situation dans la relation avec la personne accompagnée.
Contexte sociétal La thérapie phénosociale Pour qui ? Travailler sur soi Analyse et supervision