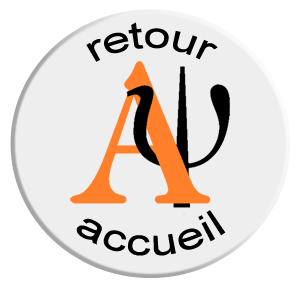La personne : de l’individu à sa situation psychosociale
La culture individualiste
On pense habituellement que chacun est autonome et seul responsable de sa vie : de ses réussites comme de ses échecs, de son bien-être comme de son mal-être. Dans cette vision, s’en sortir dépend uniquement de sa propre volonté, de son mérite personnel, ou de ses efforts individuels. Cela peut sembler valorisant, et notre culture le valorise, mais cette façon de voir l’être humain a de lourds effets :
- sur le plan personnel : anxiété, culpabilité, honte, perte de confiance, repli sur soi, isolement…
- sur la santé: stress chronique, épuisement, risques de troubles psychosomatiques ou dépressifs, fragilisation du système immunitaire, stigmatisation des personnes atteintes de handicap et de troubles psychiques…
- dans les relations : peur de montrer ses failles, difficulté à reconnaître ses besoins relationnels, faible tolérance à la vulnérabilité de l’autre…
- en famille : pression à réussir, tabou des difficultés, perte de solidarité intergénérationnelle…
- au travail : compétition interne, sur-responsabilisation, déshumanisation, déni du mal-être, perte de sens…
- et même à l’échelle du monde : oubli des solidarités, contribution à l’atmosphère de compétition permanente et au dérèglement climatique…
Certaines formes de psychothérapies peuvent renforcer ces effets, lorsqu’elles sont centrées sur l’exploration des profondeurs de la personne, qu’elles visent à atteindre des résultats avec efficacité, quand elles véhiculent l’idée que « quand on veut, on peut » ; de même que le large mouvement prônant que « nous avons en nous les ressources pour réaliser nos rêves », qu’il importe de « devenir une meilleure version de soi-même ».
Cette perspective individualiste fait peser encore plus de pression sur les épaules des personnes et oublie une réalité fondamentale :
- l’être humain est un être social, sa vie matérielle, opérationnelle, mais aussi affective, sentimentale et psychique, dépend des autres, les liens interpersonnels et les affiliations sociales sont indispensables à son existence, à sa survie, autant qu’à son épanouissement,
- cette dépendance aux autres, matérielle, relationnelle et sociale, nécessite de reconnaître que la vulnérabilité est une condition inhérente à l’humanité, et non le seul fait de la pathologie, de l’accident ou du handicap,
- la sensibilité et la solidarité, galvaudées et invisibilisées sauf dans les situations de détresse sociale et de catastrophe, sont présentes partout comme un terreau fertile indispensable de nos existences,
- mais cette dépendance ne lui évite pas de souvent s’éprouver comme seul face aux aléas de la vie, aux décisions à prendre, aux actes à poser, aux questionnements existentiels…
La personne : l’individu et sa situation psychosociale
L’humain est un être à la fois :
- Individuel-existentiel : il est inscrit dans les contours d’un corps, dans une histoire, et son vécu est influencé par son état biologique, sensoriel, corporel, émotionnel, sentimental, cognitif, par son humeur, et par les thèmes existentiels qui peuvent le travailler (liberté, responsabilité, finitude, angoisse, absence de sens, solitude, altérité…).
- Relationnel : il est inscrit dans un réseau évolutif de relations interpersonnelles et son vécu est influencé par la nature et l’état de ses liens et par les personnes avec lesquelles il est en lien.
- Social : il est inscrit dans des affiliations sociales multiples et évolutives et son vécu est influencé par la nature et l’état de ses liens d’affiliation et par ses groupes d’affiliation, eux-mêmes.
Son vécu est, à chaque instant, le fruit fluctuant d’une alchimie de ces trois dimensions, –individuelle-existentielle, relationnelle et sociale–, de même que le chemin existentiel qui se dessine au fil de sa vie.
Ces trois dimensions sont en évolution permanente et imprévisible. Des changements dans une dimension entraînent des répercussions en cascade et inattendues sur les autres. L’immense richesse et la profondeur de chacune de ces dimensions conduit à reconnaître que la situation globale est compréhensible seulement de façon approximative et éphémère, et reste toujours susceptible d’un éclairage nouveau.
Lorsqu’une personne recourt individuellement à un professionnel, elle vient seule en consultation et pourtant, tout un monde est là avec elle : sa famille, ses relations interpersonnelles, les groupes sociaux auxquels elle appartient et ses contextes de vie. Ce que la personne éprouve, pense, décide, fait dépend directement de toute cette situation complexe, et non seulement d’elle.
Appréhender la personne « comme situation psychosociale » qualifie cette façon de regarder l’être humain signifie avoir à l’esprit que ces dimensions, –individuelle, relationnelle et sociale– sont toujours présentes et actives, dans leur épaisseur, leur complexité, leur évolutivité constante et leur imprévisibilité, sans pouvoir les réduire à la seule dimension individuelle.
Plutôt que de considérer la personne comme un individu sans attache, autonome et indépendant, seul responsable de son cheminement de sa vie, de ses réussites comme de ses échecs.
Dans un monde obsédant de maîtrise et d’efficacité, prendre soin de la personne comme situation psychosociale constitue un acte politique et existentiel, qui remet la vulnérabilité, la sensibilité, la solidarité et l’imprévisibilité au centre de l’action.
Contexte sociétal La thérapie phénosociale Pour qui ? Travailler sur soi Analyse et supervision