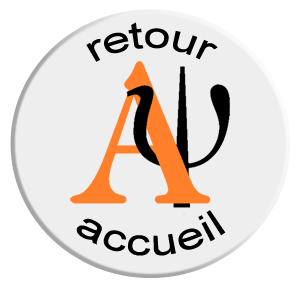L’analyse phénosociale
L’analyse phénosociale est un « travail sur soi » dans lequel l’être humain est approché dans l’épaisseur, la complexité, l’évolutivité et l’imprévisibilité de ses dimensions individuelle-existentielle, relationnelle et sociale, comme situation psychosociale, et non seulement comme individu.
Alimentée par le désir ou l’exigence éthique, et non par la nécessité et l’urgence de pallier une difficulté ou une souffrance, l’analyse phénosociale s’appuie largement sur l’expérience vécue dans le direct de l’interaction humaine avec professionnel. Bien que professionnel, ce lien est un terreau propice à la reproduction et à la mise au jour de phénomènes interactionnels et relationnels en jeu dans nos rapports avec les autres. Elle fait cependant place aux événements et situations de son histoire, de sa vie actuelle et aux situations à venir, qui peuvent apparaître dans le cours de l’analyse, accompagnés ou non de difficultés ou de souffrances.
Les phénomènes en jeu dans l’interaction et la relation entre la personne et l’analyste phénosocial sont souvent fins et subtils, requérant, de la part de ce dernier, une capacité à travailler avec le pas grand-chose, les affleurements, le presque rien, voire avec le silence et le vide, dans un rapport métonymique et métaphorique avec les événements de la vie quotidienne. Ce travail interpelle l’analyste dans son propre fil de vie en face de la personne, dans sa capacité à mobiliser son propre vécu dans l’interaction et sa capacité à être vivant dans la rencontre, tout en continuant à être au service du cheminement de la personne…
Axes de travail et effets
L’analyste phénosocial contribue à aider la personne à devenir consciente de pan inaperçus de son vécu selon deux directions :
- il aide la personne à explorer son vécu en cours dans la situation présente ou un vécu passé précis, présentifié par une remémoration guidée, afin de lui permettre d’apercevoir, de devenir consciente de phénomènes –perceptifs, affectifs, cognitifs, relationnels, sociaux– qu’elle vit sans en avoir conscience,
- il propose, dans une expérience précise ou dans l’épaisseur de la succession de situations de sa vie, des hypothèses au sujet des schèmes existentiels, relationnels, sociaux, en jeu, dont la personne peut se saisir afin d’observer leur présence dans les situations à venir.
L’exploration du vécu a un double effet de connaissance de soi selon deux dimensions :
- la personne accroît le savoir qu’elle a à son sujet, faisant évoluer l’image qu’elle a d’elle-même, son idéal pour elle-même, sa représentation de son histoire de vie, ses modalités d’orientation dans son actualité, sa compréhension de ses schèmes relationnels et sa façon d’envisager l’avenir et de se projeter,
- elle développe sa capacité de présence d’instant en instant dans le cours de toute situation, percevant en direct des phénomènes qu’elle déploie à son insu, opérant en direct des conscientisations qu’elle peut prendre en compte dans la suite de l’interaction, ouvrant ainsi de nouvelles options dans la rencontre en cours.
Il ne s’agit donc pas d’un travail d’interprétation par un analyste d’un inconscient conçu comme inaccessible en direct et à soi-même, dans une posture surplombante d’exégète.
Il s’agit d’un travail de soutien à la conscientisation par la personne elle-même de phénomènes non conscients de son vécu, l’analyste phénosocial ne pouvant pas devenir conscient de pans du vécu de la personne.
Parallèlement, au fil du cheminement, l’analyste phénosocial s’implique, avec authenticité et attention, dans les interactions avec la personne à partir de son humanité, son incarnation, ses mouvements affectifs, émotionnels, cognitifs, relationnels, contribuant à des rencontres engagées qui peuvent devenir matière pour l’exploration du vécu de la personne.
La conscientisation du vécu et le vécu de rencontres authentique et attentive ont des effets de transformation profonde de la personne.
La supervision : une exigence de lucidité et de responsabilité
Lorsque la relation humaine au cœur de l’acte professionnel, ou seulement importante dans l’activité il ne suffit pas de vouloir « bien faire » ou « faire au mieux ». Lorsqu’il s’agit d’accompagner des personnes en souffrance –psychothérapie, psychiatrie, psychologie, mais aussi médecine, soin infirmier, accompagnement social…– ou d’encadrer d’autres personnes, la dimension humaine de l’activité va au-delà du savoir et du savoir-faire : nous engageons notre manière d’être, de percevoir, de réagir, d’interpréter, ainsi que notre humanité, même lorsque la technique est mise à l’avant-plan.
Reconnaître que notre subjectivité est en jeu, que nous sommes des participants sensibles, faillibles, humains avant tout, porteurs d’une socialisation, d’une histoire, de résonances et de limites, et non de simples observateurs extérieurs ou de purs professionnels, justifie la nécessité éthique de mettre au travail notre « être-en-relation professionnel » ou notre « être-professionnel en relation » : nous-mêmes dans notre humanité professionnelle.
La supervision permet ainsi :
- de réfléchir avec un tiers qualifié à ce qui se joue dans la relation professionnelle,
- de devenir conscient de phénomènes –perceptifs, affectifs, cognitifs, relationnels, sociaux– vécus sans en avoir conscience,
- de repérer nos zones de vulnérabilité ou d’implication excessive, nos répétitions ou aveuglements,
- d’affiner notre réflexion éthique et notre posture qui en découle, d’ajuster nos positionnements, de rester du côté de la personne, sans confusion ni sur-responsabilisation.
Ce n’est pas un contrôle ni une évaluation, mais un temps d’élaboration ensemble et de soutien, de recul, de discernement et parfois de respiration. Elle contribue à prévenir l’épuisement, la rigidification ou la perte de sens.
Être supervisé, c’est prendre soin de soi, de sa pratique et des personnes accompagnées. C’est un geste professionnel et éthique, humble et responsable. Un engagement pour rester vivant, pensant, et juste… dans la relation.
L’analyste phénosocial, lorsqu’il s’est formé de surcroit à la supervision, accompagne le professionnel qui fait appel à lui en appréhendant tant le professionnel que la personne qu’il prend en charge, tenant compte des situations psychosociales, l’un et l’autre, qui contribuent mutuellement à leurs interactions et leur relation.
Contexte sociétal La thérapie phénosociale Pour qui ? Travailler sur soi Analyse et supervision